vendredi 27 mars 2009
Pensées pour A.B.
mercredi 4 mars 2009
Paris, 1927: Michel Seuphor sur le pont des Arts

L'infini est ici.
L'éternité maintenant.
C'est nous qui les vivons
le temps de notre vie,
c'est nous qui les créons
à chaque heure autrement.
Enchainés avec le tout.
Entre hier et demain.
Et le total de ces enchaînements
c'est l'être absolu
peut-être.
C'est le cercle parfait
peut-être.
Ou imparfait
(c'est mieux)
avec un très petit défaut
juste pour permettre
de poser une question
qui n'a pas de réponse
mais qui se pose quand-même
juste par erreur
par une petite erreur
tout juste
qui est la cause de tout cela
peut-être.
Michel SEUPHOR, "Inédits", in Michel Seuphor, écrits, œuvres, documents et témoignages, Paris: Carmen Martinez éditions, 1976, p. 157.
mardi 3 mars 2009
Voici, mon Frère, un peu de sable...

Portrait de Max Elskamp par Félix Valloton paru dans Le Livre des masques de Rémy de Gourmont (vol. II, Paris, Mercure de France, 1898).
"
Voici, mon Frère, un peu de sable,
Et puis aussi des grains de riz,
Le grain aux vivants secourables,
Et le sable aux morts de merci,
Et c'est tout ce que je t'apporte
Des lointains chemins que j'ai faits,
O mon Frère, qui m'attendais
En foi, après tant d'heures mortes.
"
"A mon frère Jean de Bosschère", dédicace de Max Elskamp à son ami Jean de Bos(s)chère en tête du recueil Les Fleurs vertes publié à Bruxelles en 1934.
L'Homme barbelé, ou Ferdinand universel
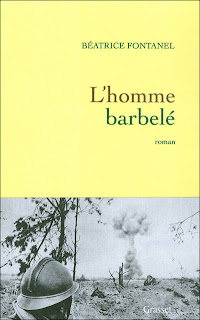
Ferdinand ne sait pas aimer. Au lieu de parler, il hurle. Au lieu de remercier, il rejette. C’est en tout cas l’image de lui qu’il donne à son épouse, Thérèse, et à ses enfants, trois garçons – le Baron, Paul, Kiki – et une fille – Pipe. Il a d’ailleurs surnommée cette dernière ainsi car elle a la lourde et unique tâche de lui apporter sa pipe, preuve du peu d’attention qu’il pouvait lui porter. Et pourtant, et pourtant… Ferdinand n’est pas le même à l’extérieur de chez lui. Souriant, parfois goguenard, il est sociable au café. Gentil avec une femme étrange dont la gorge semble avoir été tranchée de part en part comme en témoigne la longue cicatrice qui longe son cou, malgré le collier qu’elle porte pour essayer de la dissimuler.
Après ce premier portrait peu favorable, qui fait d’ailleurs dire à Kiki, le plus jeune des fils, lors de l’arrestation de son père : « Enfin, une journée tranquille ! », et nous laisse, avouons-le, quelque peu dubitatifs face aux qualités du héros qui nous est proposé, Béatrice Fontanel nous emporte vers un autre portrait, celui de la guerre, celui des guerres, de ces deux guerres immondes qui ont marqué du sang de leurs victimes les deux moitiés du précédent siècle. On y (ré)apprend, au gré de chapitres qui s’emboîtent les uns dans les autres, la boue, le sang, les larmes, l’angoisse, l’alcool, l’urine et les gaz. Comment les soldats qui étaient sur le front de Verdun en 1916 ont été marqués à jamais par cette expérience à la fois exaltante et décourageante. Comment ils sont devenus des « hommes-barbelés », des « hommes-boue », des « hommes-trains ». Comment les âmes en construction de ces jeunes mobilisés se sont transformées en une vase lénifiante et gluante. Comment elles ont été définitivement brisées.
Ironie du sort, Ferdinand connaît aussi la déportation, lors de la seconde guerre mondiale. Les camps d’extraction de minerai à Mauthausen, la cueillette des escargots pour tenter de survivre – un peu –, la dysenterie, les trains bondés, l’odeur des cheveux et des ongles brûlés dans les fours. Une nouvelle fois, il est confronté à la réduction de la race humaine en de simples outils logistiques même pas dignes d’être entretenus.
Béatrice Fontanel ne juge pas. Elle explique, petit à petit. Peu à peu. En même temps qu’elle découvre – du moins nous le fait-elle croire. Elle n’excuse rien, ni le caractère ignoble de Ferdinand envers les siens, ni la violence des Allemands. Elle constate, simplement. Partie d’une histoire familiale, elle lit des archives, se rend sur les lieux des crimes et elle constate. Elle constate que Ferdinand avait un peu plus de vingt ans lorsqu’il est parti sur le front de 14-18. Constate qu’il y a fait preuve de courage et de camaraderie. Constate qu’il y a vécu les gaz, les pulsions meurtrières des siens envers l’ennemi ou envers eux-mêmes, la mauvaise gestion des troupes par l’Etat français, les hommes qui marchent pieds nus et boivent l’eau des trous d’obus où baignent des cadavres. Elle constate que Ferdinand n’a pas su aimer ses enfants. Constate qu’il a traversé les camps sans même être surpris de la barbarie qui y avait cours. Elle constate aussi qu’une jeune femme, fuyant les bombardements de Dresde par les Alliés, emmenait, dans sa valise, les restes de son enfant calciné.
Les conflits mondiaux ont déjà donné lieu à une abondante littérature. Outre les livres nationalistes ou pacifistes parus dans les années 1920-1930 et les témoignages issus des camps, il ne se passe pas une année sans qu’un livre ou un film n’aborde le sujet. Petit à petit le voile se lève : après l’enfer des tranchées (Tardi, C’était la guerre des tranchés, 1993, ou le recueil Paroles de poilus, 1998), on découvre ou redécouvre le rôle joué par les indigènes (Indigènes, 2006), les gueules cassées (
A l’aube de la disparition des derniers témoins vivants ayant vécu ces drames humains – à l’image de cette page 254 qui s’envole dans le roman et que l’auteur doit aller chercher sur les toits –, il y a encore beaucoup à faire pour mesurer les conséquences, humaines et psychologiques, de la violence de ces conflits sur nos sociétés actuelles. Pour se rappeler la violence de l’Algérie, ou, plus récemment, celle des conflits au Proche-Orient. Et se dire qu’il est peut-être, enfin, temps d’arrêter. Tel est, nous semble-t-il, la fonction de ce livre salvateur, à la fois âme de notre âme et piqûre de rappel. A la fois témoin de la souffrance des uns et témoin de sa répercussion sur les autres. Sans être un pamphlet contre la guerre, il s’agit bien, ici, d’un plaidoyer pour la paix. Probablement afin, qu’il n’y ait plus, définitivement, « d’hommes dont les morts ont violé les âmes » (le poète Wilfred Owen, cité p. 199).
Béatrice Fontanel